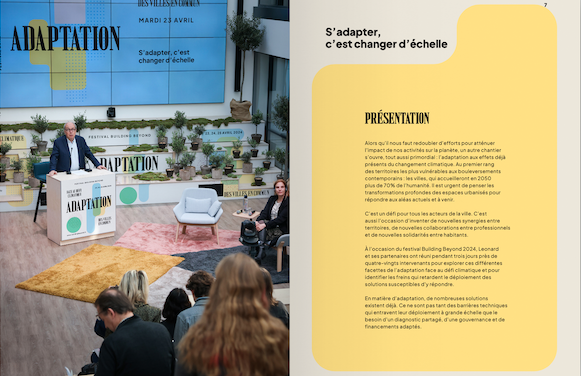Comment se manifeste la biodiversité en ville ?
Philippe Clergeau : Parle-t-on de nature ou de biodiversité ? La différence est importante. La nature en ville, c’est quelque chose que l’on fait assez bien aujourd’hui : on végétalise, on fait de l’horticulture. Quand on traite de biodiversité, on est sur une autre relation entre les espèces végétales, animales, et l’homme : on parle d’écosystèmes. Cela m’a amené à écrire souvent que la ville durable ne pouvait pas exister sans une intégration de l’écosystème urbain dans un écosystème régional, avec le développement d’une vraie biodiversité reposant sur des espèces plutôt locales. Jusqu’à récemment, on faisait tout pour qu’aucune espèce ne puisse s’installer en ville, en déversant des pesticides, en nettoyant systématiquement les trottoirs… On visait des espèces horticoles pour leurs qualités esthétiques, et on tolérait quelques espèces animales comme les canards ou les petits oiseaux. Suite au Grenelle de l’environnement, la suppression des pesticides en ville a été un élément fort de changement. Cela a permis à toute une petite flore – les “mauvaises herbes” – de s’installer, on a commencé à voir plus d’insectes, puis des prédateurs d’insectes, etc… On a retrouvé des chaînes alimentaires.
Isabelle Spiegel : Dans l’inconscient collectif, on a associé la biodiversité urbaine à des ruches en toiture, ce qui est un peu dangereux. Si le rôle des pollinisateurs est essentiel, il est loin de suffire. Il faut recréer dans les espaces urbains des habitats complets, qui vont accueillir des espèces végétales et animales. Je pense aux trames bleues et vertes : il s’agit de proposer des points de chute. Je pense aux oiseaux migrateurs qui doivent pouvoir traverser une mégalopole en retrouvant des mares ou des habitats qui répondent à leurs besoins de migration.
En quoi la biodiversité est-elle un sujet d’importance ?
PC : Les enjeux liés à la nature en ville ont été bien exposés autour de ce que l’on appelle les services écosystémiques. Ce sont les services que la nature rend aux citadins comme la régulation de la pollution ou la régulation des inondations. Il y a également un enjeu culturel énorme, nous avons besoin de végétation en ville, de marcher sur une pelouse, de croiser des arbres. Il ne faut pas oublier les services de production, avec l’agriculture urbaine qui se développe, même si elle restera toujours un peu marginale. Enfin, le plus avancé aujourd’hui concerne les services de santé : toutes ces régulations qui amènent un confort et une qualité sanitaire au citadin, notamment contre les îlots de chaleur.
IS : Je retiens deux chiffres marquants. Le premier concerne la disparition des espèces, 100 à 1000 fois plus rapide aujourd’hui que la vitesse naturelle d’extinction. L’autre concerne la démographie : 2,5 milliards de personnes en plus vivront dans les villes entre aujourd’hui et 2050. Cela représente 65 nouvelles mégalopoles de la taille de Tokyo. Si la conquête de ces nouveaux espaces passe par l’artificialisation, nous allons mettre une pression impossible sur une biodiversité qui régule le cycle du carbone, le cycle de l’eau, la photosynthèse. Les services rendus par la nature vont bien au delà de la chaîne alimentaire. Les “villes éponges” par exemple, vont absorber une partie du surplus d’eau en cas de crue ou d’inondation, et posent la question de l’aménagement d’espaces volontairement inondables.
Comment valoriser cette biodiversité ?
PC : En s’appuyant sur une ingénierie écologique. Avec mon équipe, nous travaillons beaucoup sur les trames vertes et bleues, sur les corridors, pour favoriser l’installation d’une biodiversité forte. Nous travaillons aussi sur les bâtiments. Aujourd’hui, 90% des toitures végétalisées sont couvertes de sedum, une petite plante grasse qui ne nécessite que 2 à 3 cm de substrat. Nous avons démontré que la diversité animale ne s’installe pas dans ces conditions, et la diversité végétale très peu. L’apport de l’ingénierie écologique a été d’inviter à une plus grande épaisseur du substrat pour favoriser l’installation de graminées, voire de petites arbustes et d’insectes.
IS : Un autre enjeu aujourd’hui est de savoir évaluer l’apport de la biodiversité. Il n’existe pas d’indicateur simple de valorisation. Un inventaire de la Commission Européenne vient juste d’être publié et parle de 80 méthodes différentes d’évaluation. La mise en place de ces indicateurs est fondamentale, pour toucher les décideurs, et pour intégrer ces éléments de valorisation des écosystèmes dans l’ensemble des projets. Selon moi, une des priorités est de réfléchir à l’échelle des quartiers et plus seulement d’un bâtiment ou d’un parc, dans une approche intégrée. Aujourd’hui, sur une friche industrielle plutôt pauvre en biodiversité, on sait générer des résultats positifs, mais ils restent difficiles à mettre en avant. On passe par des indicateurs de moyens, comme la suppression des produits phytosanitaires. La biodiversité reste un des parents pauvres de l’analyse environnementale en termes de méthodes.
Quelles sont les barrières au développement de la biodiversité en ville ?
PC : Ce n’est pas dans la culture de nos concepteurs. La conception urbaine est loin de l’approche écologique, même si le vent tourne un peu aujourd’hui dans le sillage d’une demande sociétale énorme. La plupart des villes sont conscientes de l’importance de développer autre chose que de belles mosaïques de fleurs, c’est accepté à peu près partout. Elles ont également conscience qu’il faut limiter certaines espèces trop invasives et privilégier les espèces locales. Mais pour aller plus loin et modifier notre aménagement urbain, il faut toucher les urbanistes, les décideurs, les promoteurs… Lorsque les villes arrivent à faire bouger les lignes, c’est souvent grâce à la volonté très forte d’un maire ou d’un premier adjoint.
IS : J’ai déjà parlé des indicateurs : nous devons nous mettre d’accord sur les objectifs. Cela débouche directement sur la question des compétences. Nous avons besoin d’écologues, mais les profils spécialisés restent rares. Il faut trouver le bon niveau entre une expertise de pointe et la diffusion du minimum de compétences auprès des opérationnels usuels. Les promoteurs immobiliers et les chefs de projets doivent développer une connaissance des enjeux de biodiversité pour les anticiper dans la conception. Depuis plus de 50 ans, les marchés de la ville sont très morcelés. Dès qu’on aborde le sujet de la biodiversité il faut redessiner les frontières entre les différents acteurs, dans un espace encore peu réglementé. Si l’on souhaite être en avance de phase vis à vis de la réglementation, on se confronte vite à des questions de gouvernance.
Quels sont les arguments financiers pour le développement de la nature en ville ?
PC : L’argument du prix revient tout le temps, et effectivement la modification des pratiques actuelles entraîne un surcoût. Mais si on regarde sur du moyen terme, c’est gagnant. Il est plus facile de donner un coup de Karsher sur un trottoir que de tondre une pelouse. Mais face aux canicules et aux inondations, ce sont bien les surfaces de pleine terre, végétalisées, qui vont permettre une régulation. Un boulevard végétalisé affiche toujours 3 à 5 degrés – voire 8 – de différence avec le même boulevard sans arbre.
IS : Le business model n’est pas évident. Nous recevons tous les services de la biodiversité de façon naturelle – les abeilles pollinisent – mais on ne sait pas le chiffrer. Le retour en termes de valeur créée est important mais il n’est pas immédiat…
Doit-on repenser l’idée même de ville telle qu’on la conçoit aujourd’hui ?
PC : Je n’ai pas du tout de vision de la ville idéale. Les stratégies ne sont pas valables partout. Nous avons plutôt des grandes lignes : on sait qu’il faut faire des corridors verts pour que les gens se promènent, il faut limiter le nombre de véhicules, électriques ou non… Aujourd’hui je travaille sur l’objectif de “zéro artificialisation nette” : comment faire pour que la ville arrête de s’étaler, sans surdensifier. Je suis également directeur scientifique d’un programme du Ministère de la Transition écologique et solidaire et on vient de lancer un appel d’offre Biodiversité, Aménagement Urbain et Morphologie, qui va financer des projets sur la forme de la ville.
IS : Je pense qu’il est essentiel de penser la ville dans son ensemble, quartier par quartier, et de penser aux différents services que doit rendre cette ville. Il n’est plus concevable d’habiter à l’ouest d’une ville et d’aller travailler à l’est, de partir en weekend le dimanche pour aller trouver un peu de vert et de faire deux heures de bouchons. Il faut réconcilier les différents usages et penser la ville comme un écosystème qui réponde aux besoins de se loger, de se nourrir, de s’approvisionner, de travailler, etc… C’est une démarche systématique. Même si on pense la ville en verticalité, avec des tours de grande hauteur, il faut penser comment y amener la nature, pour garder un équilibre dont on a besoin.
Un mot de la fin ?
PC : Nous devons viser un paysage vivant et pas simplement un paysage esthétique : c’est un nouveau paradigme important. Il ne faut pas imaginer qu’un peu de mobilier vert et de végétalisation vont résoudre nos problèmes. Il faut absolument travailler sur la pleine terre, c’est un enjeu fondamental pour conserver une ville qui ne soit pas complètement bétonnée, qui puisse survivre aux chaleurs, aux inondations, aux pandémies. C’est un bon exemple : plus on a d’espèces, plus notre capacité de filtrage des germes est grande. Une espèce très abondante, comme l’homme, est un terrain de prédilection pour le développement des virus.
IS : Le sujet n’est pas nouveau, mais il est en train de prendre une vraie ampleur. On sent un intérêt croissant des opérateurs, des maîtres d’ouvrage ou du BTP, qui est relativement récent. Il y a encore beaucoup à faire mais j’espère que les marchés vont se dynamiser et se structurer. Nous n’avons pas d’autre choix que d’intégrer la biodiversité dans l’écosystème urbain.