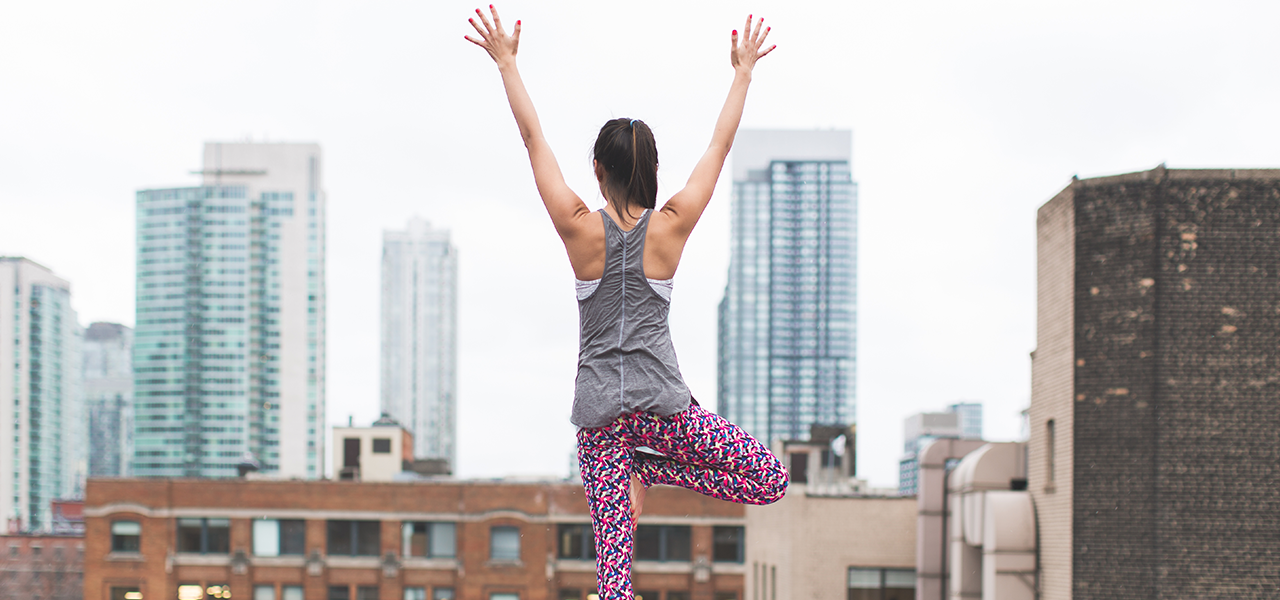
La Smart City a un problème. Constamment invoqué, le concept se dilue dans la profusion des discours. Toute approche technologique de la ville semble aujourd’hui rentrer dans la définition. On ne compte plus les entreprises qui ont présenté leur plan pour la Smart City au CES en 2018. Côté grands groupes, Google va rénover tout un quartier de Toronto avec Sidewalk Labs, entité d’Alphabet dédiée à la ville. Bosch s’attaque indistinctement à la qualité de l’air et au parking. Côté startups, le chargeur électrique du futur côtoie le guidon connecté… Comme le décrit Olivier Ezratty dans son traditionnel rapport dédié au salon, on observe “un bric à brac assez hétéroclite de solutions”.
C’est dans ce cadre conceptuel flou qu’a émergé l’idée de Responsive City. Bien qu’elle s’appuie sur les mêmes leviers – data, IoT, automatisation – que la Smart City, cette dernière a le mérite de se définir par sa finalité : le citoyen. L’ouvrage éponyme de Stephen Goldsmith et Susan Crawford posait déjà en 2014 les bases d’une villes intelligente qui mettrait les données au service de l’usager de la ville. Après tout, “qu’est ce qu’une ville sinon ses habitants”, écrivait Shakespeare dans Coriolan…*
Le concept fait écho aux craintes d’une ville toute technologique, terrain de jeu – et de business – des grands groupes industriels et autres GAFAM, au détriment du citoyen et d’un traitement équitable des habitants. “Si la gouvernance d’une ville ne tenait qu’à l’efficacité, vous n’enverriez pas de bus dans les zones rurales ou pauvres”, s’inquiète Pamela Robinson dans le New York Times à propos du projet de Google à Toronto. Ghettos ultra-connectés réservés aux populations les plus riches, surveillance de masse permise par la collecte systématique des données, conflits de gouvernance entre acteurs publics et privés : le cadre conceptuel de la Responsive City ne remet pas en cause l’émergence d’une ville intelligente, mais il en interroge efficacement les limites.


